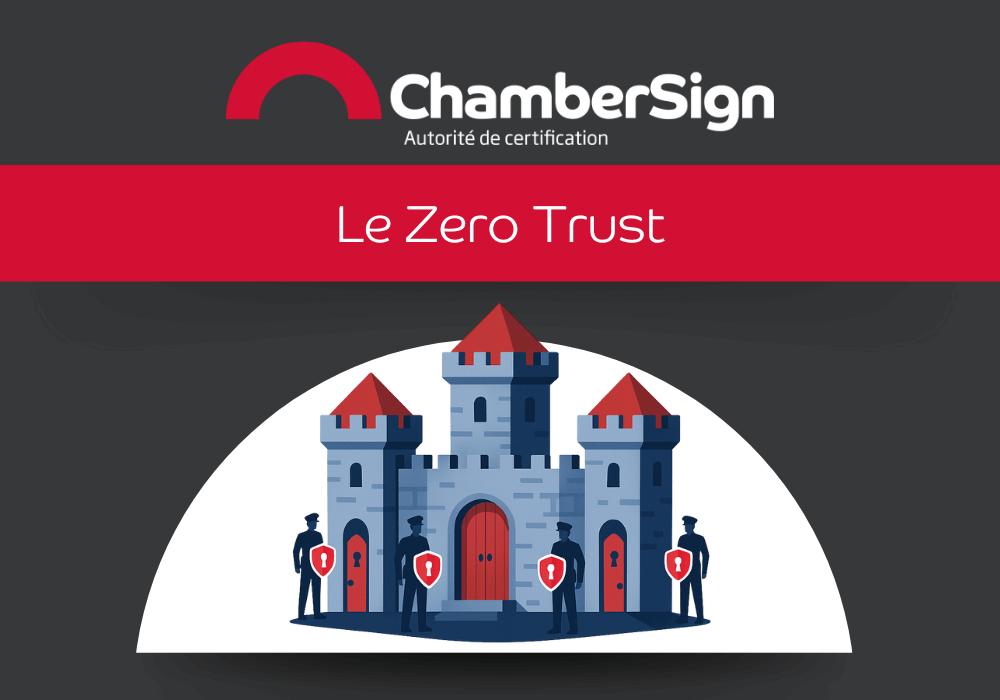Les modèles de sécurité classiques reposaient sur une frontière claire entre un « intérieur sûr » et un « extérieur dangereux ». Cette approche présente aujourd’hui de sérieuses vulnérabilités :
- Menaces internes : Erreurs humaines, employés malveillants, ou comptes compromis qui opèrent déjà « à l’intérieur » du périmètre.
- Mobilité croissante : Les collaborateurs accèdent aux systèmes depuis des appareils variés, des réseaux publics, et des lieux géographiques dispersés.
- Adoption du cloud : Les frontières deviennent floues quand les applications et données migrent vers des services cloud externes.
- Mouvements latéraux : Une fois à l’intérieur, un attaquant peut se déplacer librement d’un système à l’autre sans contrôle supplémentaire.
La transformation digitale a créé un environnement distribué, hybride et centré sur le cloud, où étendre le périmètre n’est plus une solution viable.
Les cinq piliers du Zero Trust
Le modèle Zero Trust repose sur cinq piliers essentiels qui forment une défense en profondeur proactive et évolutive :
- Vérification systématique
Tous les accès doivent être vérifiés, qu’ils proviennent de l’intérieur ou de l’extérieur du réseau. Chaque demande d’accès déclenche une vérification complète : identité de l’utilisateur, légitimité de l’appareil, contexte de la demande (heure, lieu, type d’accès). Cette vérification s’accompagne de mécanismes de contrôle à tous les niveaux de l’architecture.
- Accès au moindre privilège
Les utilisateurs et appareils n’obtiennent que les permissions strictement nécessaires pour accomplir leurs tâches. Un développeur accède aux environnements de développement mais pas aux données clients. Un commercial consulte son CRM mais ne peut pas modifier la configuration réseau. Cette approche réduit drastiquement la surface d’attaque.
- Surveillance continue
L’activité du réseau est constamment analysée pour détecter les comportements suspects. Le système apprend les habitudes normales de chaque utilisateur et alerte en cas d’anomalie : accès inhabituel, transfert de volumes de données anormaux, ou connexions depuis des géolocalisations suspectes.
- Microsegmentation
Le réseau est divisé en petites zones sécurisées isolées les unes des autres. Si un attaquant parvient à compromettre le poste d’un comptable, il ne peut pas automatiquement accéder aux serveurs de développement ou aux bases de données marketing. Chaque segment nécessite une authentification spécifique.
- Automatisation et orchestration
L’automatisation simplifie et accélère les processus de sécurité : authentification, autorisation, détection des menaces. Elle permet une réponse rapide et cohérente face aux incidents, sans intervention humaine pour les cas standards.